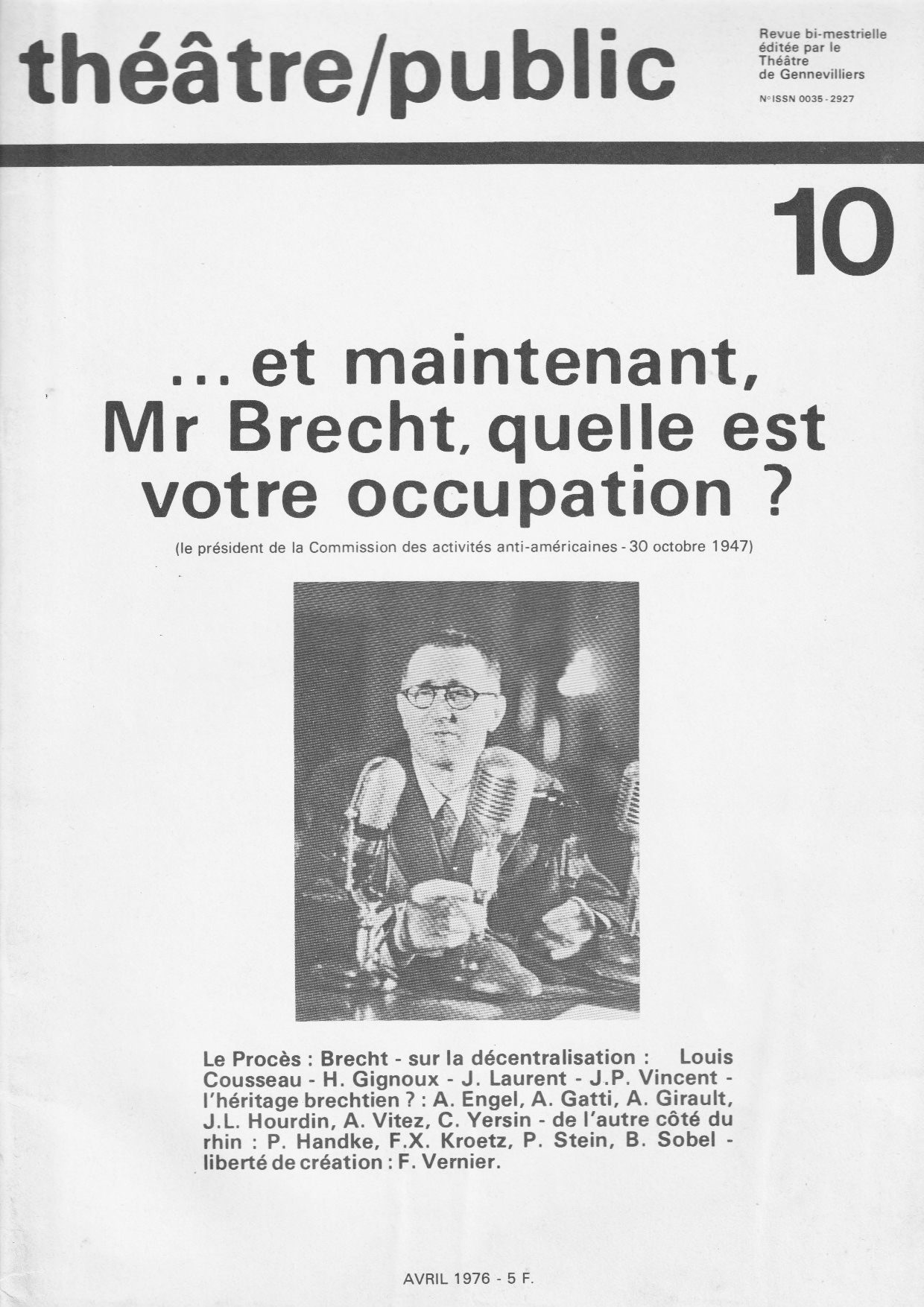Ce texte d'Hubert Gignoux est paru en mars 1965 dans le Bulletin de la Comédie de l'Est. Avec le recul du temps, l'auteur de l'article considère que la formulation des problèmes est incomplète ou dépassée. Cependant, outre sa valeur de témoignage sur l'état de la décentralisation dans sa "période héroïque", ce texte permet de mettre en perspective les productions artistiques et les interrogations esthétiques de la décentralisation d'aujourd'hui et ainsi de mesurer l'ampleur du chemin parcouru.
M. Thierry Maulnier de l’Académie Française, vient de répéter, dans le premier numéro d’une revue intitulée « Cahiers du Théâtre » une attaque qu’il avait déjà formulée dans la Revue de Paris en juin dernier. Après une analyse, souvent judicieuse, de la situation économique du Théâtre français il déplore que l’aide financière de l’Etat soit accordée par priorité aux Théâtres « populaires » (T.N.P., Centres dramatiques, Maisons de la culture) et que ceux-ci, se consacrant au service d’un répertoire « idéologique à tendance marxisante » ne présentent que des « oeuvres – pour la plupart étrangères – à tendance politique ou des chefs d’oeuvres classiques susceptibles de politisation »…
Comme le C.D.E. était visé en juin pour Le singe velu et qu’il l’est aujourd’hui pour Horace[1], je me sens en droit de faire une mise au point.
Je pourrais d’abord répondre par des faits. Il est difficile de soutenir, si l’on veut bien consulter la liste des pièces présentées depuis une dizaine d’années par les Théâtres mis en accusation, qu’elles répondent systématiquement à l’orientation dénoncée par Thierry Maulnier. Il est difficile de soutenir qu’à Bourges et à Caen par exemple, où deux Maisons de la Culture viennent d’être créées et prospèrent, « l’extrême-gauche exerce une grande influence ». Il est difficile de soutenir que les théâtre populaires sont les instruments d’un complot « au dessein profond » ou que leur clientèle déjà lassée se précipite vers le boulevard. Il est même difficile de soutenir, hélas, que Dasté ou moi, voire Reybaz, Sarrazin et Wilson sont des jeunes animateurs.
Mais plutôt que m’attarder à ces évidences, je préfère m’en prendre à deux confusions commises par notre censeur et qui méritent d’être dissipées car, se répandant, elles pourraient devenir nocives et servir, elles, pour de bon, à des fins politiques : selon lui un théâtre critique ne peut être que marxisant et d’autre part, forcément didactique et indigeste, il ne saurait être « un divertissement, une poésie ».
C’est tout de même aller bien vite et d’une façon bien irréfléchie ! Pour ma part autant je tiens au rôle critique du théâtre dans la mesure où je le crois un gage de liberté, autant je me refuse à concevoir une critique à sens unique, et autant j’estime que le théâtre doit poser des questions, autant je répugne à ce qu’il y réponde. Quel est, alors, mon « engagement » ? Bourgeois, vivant dans une société bourgeoise, c’est elle qu’il m’arrive de mettre en cause par les pièces que le C.D.E. joue, parce que je crois utile de lutter à ma façon contre le confort intellectuel et moral qui la menace comme il menace toute société établie et parce que ce qui se passe sur la Lune ou Mars m intéresse moins. Mais je ne songe pas à imposer une pensée. Je ne veux être qu’un empêcheur de penser en rond. Thierry Maulnier s’est-il demandé quelles pièces je jouerais sous un régime communiste ? Les siennes, peut-être[2], ou d’autres qui le surprendraient. Il est vrai que je ne pourrais pas les jouer[3].
En second lieu, si Thierry Maulnier voulait bien lire dans le dernier numéro de la revue Théâtre Populaire (Marx encore !) l’article intitulé « Le C.D.E., organisation et tendances » il y constaterait, avec mon goût pour le théâtre « critique », celui que j’ai pour la magie théâtrale et mon aversion pour le rationalisme, pour le positivisme didactiques vers lesquels ont pu glisser certains commentateurs abusifs de Brecht. Il y trouverait ma référence à la Tempête de Shakespeare comme à un modèle de critique par la magie[4]. Et si mieux encore il parcourait de bout en bout ces « Cahiers du Théâtre » auxquels il collabore il y lirait que Brecht lui-même n’a pas pu s’empêcher d’être un « poète du théâtre ». Je lui demanderais alors comment il se fait que la même publication, pour les commodités de sa cause, range Brecht, page 17, parmi les doctrinaires ou les agitateurs et, page 34, parmi les maîtres exemplaires du « Théâtre de toujours ».
J’aurais beaucoup de choses encore à lui demander, car, en dehors de ces deux confusions réfutables en quelques mots et qui n’ont pu se produire, dans un esprit aussi éclairé, que sous l’effet de quelque passion, son exposé tout entier est ambigu. Après l’avoir lu et relu je suis incapable de dire qui sont, où sont les malheureux auteurs français, coincés paraît-il entre le théâtre de boulevard et le théâtre de l’absurde, ne voulant ni de l’un ni de l’autre et à qui les théâtres populaires ne feraient pas leur place. Sont-ils nés ? Sont-ils à naître ? Quelle chance leur est refusée ? Mystère. Je suis incapable de dire si ce texte préconise l’intervention de l’Etat ou son abstention, la recherche d’un nouveau public, fût-ce au moyen d’un « dumping », au moyen de prix de places anormalement bas, ou plutôt l’imposition à ce public « parce qu’il goûte mieux les plaisirs qui lui ont coûté effort et sacrifice » de prix plus élevés, ou encore le repli pur et simple sur le public qui peut payer 20 F. son fauteuil.
En vérité Thierry Maulnier ne peut pas ne pas écrire que la culture est le bien de tous et que le théâtre est un instrument de culture, et l’ayant écrit il ne peut pas ne pas en conclure que, dans la situation contemporaine dominée par les moyens de culture de masse, l’intervention de l’Etat est indispensable à la vie d’un art coûteux, exigeant et minoritaire. Mais cela l’ennuie bien et il voudrait que ce qu’il est obligé de souhaiter, pour être lui aussi « dans le vent », se fasse sans se faire, tout en se faisant.
En vérité si la pensée politique qu’il prête aux animateurs de troupes populaires lui déplaît tant c’est surtout parce qu’elle n’est pas la sienne qu’il dissimule, comme c’est l’usage, sous un libéralisme ostentatoire. En vérité il est un peu trop question dans ces nouveaux « Cahiers du Théâtre » de « choses éternelles » et du « Théâtre de toujours » et quand cela n’est pas dit, cela est impliqué. Nous voilà aux essences, celle de l’homme, celle de la poésie, celle de l’art. Nous voici à une pensée de droite, qui l’est bien plus que la mienne n’est de gauche. Nous voilà à l’immobilité, cette singerie ordinaire de l’éternité.
En vérité tout cela me fait penser au cher Léopold-Auguste du Soulier de satin : « Qu’on me donne du nouveau. Je l’aime. Je le réclame. Il me faut du nouveau à tout prix… Mais quel nouveau ? Du nouveau, mais qui soit la suite légitime de notre passé. Du nouveau et non pas de l’étranger. Du nouveau qui soit le développement de notre site naturel. Du nouveau, encore un coup, mais qui soit exactement semblable à l’ancien ».
M. André Roussin, dans le Figaro Littéraire du 18 février dernier, prend lui aussi à partie les Théâtres « populaires » et, s’il politise moins le débat, s’il dénature un peu moins les faits, si, par bonne grâce naturelle, il sait mettre plus d’humour dans son réquisitoire, il n’est pas en reste d’injustice.
Il me permettra donc de lui faire, à lui aussi, quelques remarques:
– Il intitule son article « Nous les maudits du Théâtre » et qui « Nous » ? Lui-même, Achard, Pagnol, Bourdet, Aymé, Marceau… maudits par les Centres et Maisons de la Culture qui ne les jouent pas. On croit rêver. Nous autoriseraient-ils à créer leurs pièces, tous ces Messieurs, si nous les leur demandions pour 40 représentations au lieu des longues séries qu’ils peuvent espérer à Paris ? Quant à les reprendre simplement, quel intérêt cela peut-il avoir pour nous et pour notre public lorsque Karsenty ou Herbert les ont déjà « tournées » ? Et puis l’étrange épreuve, cette malédiction accompagnée du succès, de la fortune et parfois des honneurs ! Il n’y a pas si longtemps que les vrais maudits étaient ces braves scouts culturels qui devaient s’estimer heureux de gagner entre 60.000 et 120.000 anciens francs par mois en tâchant de faire rattraper à la banlieue parisienne et à la province les 20 ou 30 ans de retard qu’elles avaient pris dans leur information théâtrale. Quand ils n’en étaient qu’au tâtonnement et à l’inconfort tout le monde s’attendrissait sur leur courage. Qu’y a-t-il de changé en 1965 pour qu’on leur cherche noise ? Ils gagnent un peu plus, ils prétendent gagner davantage, ils s’approchent du confort, ils atteignent la qualité et ils remplissent leurs salles à plus de 80%, c’est tout. Car pas plus qu’ils n’étaient tous brechtiens hier, pas plus ils ne le sont aujourd’hui. De là à conclure qu’on les attaque surtout parce qu’ils dérangent des situations acquises et qu’on invente alors, pour l’accrocher à leurs basques, l’étiquette qui leur nuira le mieux, il n’y a qu’un pas. Franchissons-le. D’ailleurs il faut que les troupes qu’ils ont réunies et le public qu’ils ont conquis aient quelque attrait pour que tant d’auteurs renommés souffrent d’en être éloignés. Que manque t- il en définitive, aux opulentes victimes sur lesquelles on nous invite à gémir ? Qu’on leur dise qu’ils sont les égaux des plus grands ou que les plus grands ne sont pas si grands qu’on le croit. Mais est-ce notre faute si le 20e siècle compte déjà quatre vrais géants du Théâtre : Strindberg – Pirandello – Claudel (le premier pour moi) et… Brecht et si c’est d’eux d’abord que nous vient la lumière ?
– André Roussin écrit: « On purge bébé, c’est la culture. Topaze, Le Sexe faible ou Jean de la Lune, c’est le théâtre bourgeois auquel le peuple n’aura pas droit ». Non, mais la pièce de Feydeau est parfaitement réussie et les trois autres le sont moins[5]. Mérite le respect, est exemplaire et, si l’on veut, culturelle, toute oeuvre qui atteint à la perfection dans les limites fussent-elles étroites, que l’auteur s’est lui-même fixées. C’est le cas d’On purge bébé et tout esprit exigeant est fondé à ne pas mettre au même niveau des oeuvres qui, non seulement sont moins accomplies, mais prétendent passer pour plus qu’elles ne sont. J’ajoute que, dans ses meilleurs moments de délire logique, Feydeau, malgré ses lits et ses caleçons atteint à une poésie, proche de celle des clowns, qui justifie son rang et dont ses émules ne sont pas toujours capables. Car c’est bien de poésie et de style qu’il s’agit dans cette affaire plus que de signification ou d’idéologie. Je dois être un des seuls directeurs de Centre qui aient monté une pièce de Louis Verneuil et deux de Jean Anouilh. Est-ce ma faute si la majorité du public pour lequel je travaillais alors me l’a reproché ?[6]
– André Roussin estime à la fois que les théâtres « populaires » n’ont suscité aucun auteur nouveau et que plusieurs de nos plus importants créateurs, un Beckett ou un Genet, par exemple (quel mélange de tendances et de talents ! mais je n’en suis pas responsable), sont exclus du contact populaire. La première proposition n’est qu’à moitié vraie car elle refuse tout crédit à Gatti, à Planchon, à Lebesque, à Marrey, à Halet, à Vauthier, à Hélias et elle compte pour rien, parce qu’ils n’en sont plus à leurs débuts, le service d’un auteur de 43 ans comme Dürrenmatt, de 54 ans comme Frisch ou d’un auteur mort avant la diffusion qu’il méritait comme O’Neill. La seconde est tout-à-fait exacte mais d’où vient le divorce qu’elle déplore ? Pas plus du mauvais vouloir du public populaire, que de celui des animateurs « engagés » ou des grands écrivains en question. Ne viendrait-elle pas d’une fatalité de la culture française qui, le Moyen-Age révolu, s’est isolée dans son aristocratie soit par une option délibérée des écrivains[7], soit faute de trouver des traditions artistiques populaires où s’enraciner ?
Ce problème, trop vaste et trop complexe, dépasse ma mesure, mais c’est peut-être lui qu’il aurait été juste d’évoquer au lieu de faire je ne sais quel procès aux hommes qui s’efforcent de le résoudre, vaille que vaille, au jour le jour, par le réveil des esprits, par des transfusions de sang étranger[8] et par la recherche dans les textes, dans le jeu et dans les édifices, d’une esthétique ouverte.
Notes
[1] « On fait de Horace de Corneille un réquisitoire contre les horreurs de la guerre ».
[2] La Course des rois, Le Profanateur, La Maison de la nuit, La Maison au fond de la mer, Jeanne et ses Juges, Le Sexe et le néant.
[3] En 1976, 11 ans après, je m’en veux d’avoir écrit cette sottise pour ôter un argument à l’adversaire. Non seulement aucune censure ne me contraindrait mais ce serait peut-être une bonne information culturelle de montrer jusqu’où une certaine dramaturgie bourgeoise universitaire a pu aller.
[4] Sans parler d’Aristophane et du Molière des Comédies-Ballets.
[5] Ici apparaît ce qu’on peut appeler la tactique du train. On choisit une locomotive indiscutable et on lui accroche des wagons inégalement dignes d’elle qui profitent du voyage.
[6] L’Archipel Lenoir de Salacrou ne m’a pas valu cette mésaventure. D’autre part, le CDE a joué Audiberti (le mal court) avec succès. S’il na pas encore abordé Beckett ou Ionesco c’est parce que d’autres troupes ont eu l’occasion de les présenter à son public.
[7] Cf. Thierry Maulnier « Introduction à la poésie française » p. 33 à 66.
[8] Combien Corneille doit-il aux espagnols, Molière aux italiens. Claudel aux chinois et aux japonais
Pour citer cet article
Hubert Gignoux, « Un épisode de la décentralisation », Théâtre/Public, N° 10 [en ligne], URL : https://theatrepublic.fr/tp010-un-episode-de-la-decentralisation/